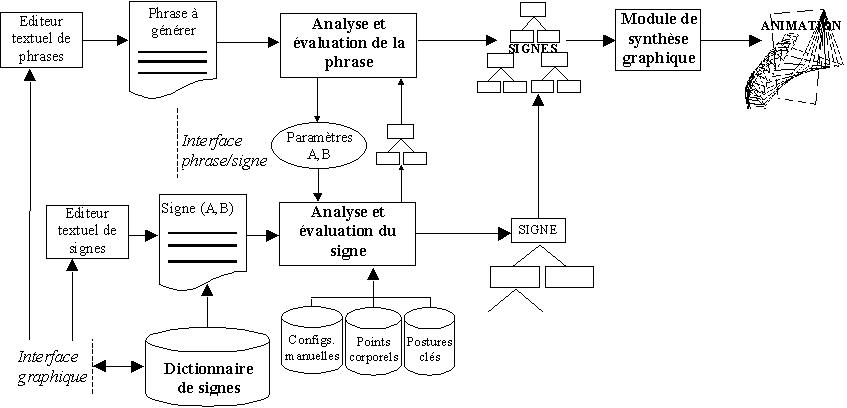
3.3. Présentation, évaluation et utilisation du logiciel.
A présent que les différentes fonctionnalités
ont été introduites, nous allons examiner comment
celles-ci s’organisent dans la structure globale du logiciel.
Ce dernier a par ailleurs fait l’objet d’une procédure
d’évaluation, dont les résultats sont également
détaillés dans cette partie. Pour finir, nous décrivons
un exemple d’utilisation des signes synthétiques,
à savoir leur intégration dans l’application
LAC présentant des corpus lexicaux.
3.3.1. Présentation du logiciel.
Dans cette partie est exposé le logiciel de synthèse
que nous avons développé, d’abord de façon
globale pour en appréhender l’organisation des composants
essentiels. Y sont ensuite abordés de manière plus
détaillée l’éditeur et son interface
graphique, le module de visualisation 3D, et enfin le dictionnaire
de signes.
3.3.1.1. Présentation générale.
Du point de vue de l’utilisateur, la synthèse de la phrase signée s’articule en trois étapes principales :
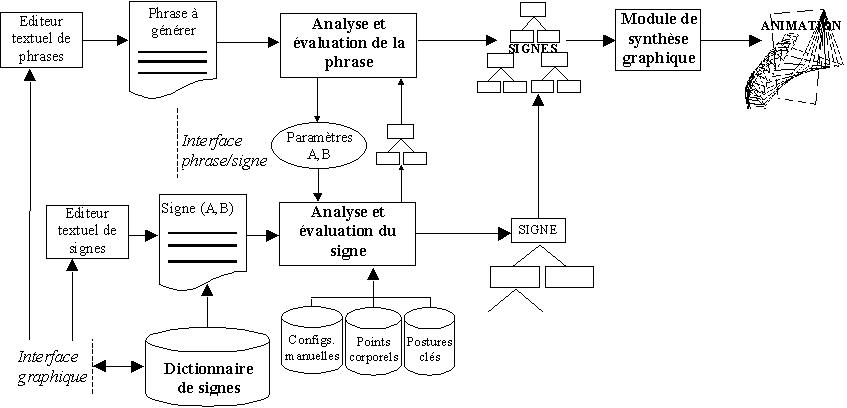 |
|
|
3.3.1.2. L'éditeur et son interface graphique.
Les outils de spécification de la phrase et du signe se présentent, dans leur forme de base, comme de simples éditeurs de texte dotés de menus permettant de lire et de sauvegarder leur contenu dans un fichier et offrant les commandes d’édition classiques (copier/couper/coller, annuler, ...), ainsi que d’un item pour en lancer l’évaluation.
La barre d’état affiche en outre divers messages à l’adresse de l’utilisateur. Elle permet de suivre la progression du calcul, et signale les éventuelles incorrections syntaxiques ainsi que les erreurs survenant lors de l’interprétation (messages inconnus, points de l’espace hors de portée, etc.). Les termes incriminés sont mis en évidence pour en faciliter la correction (figure 3.28).
 ð ð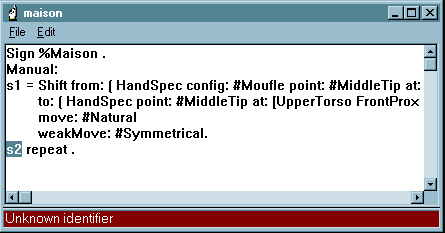 |
|
|
|
Afin de faciliter la tache d’édition et réduire les risques d’erreurs lors de l’évaluation de la partie manuelle du signe, nous avons développé une interface graphique qui en génère automatiquement le code descriptif. Celle-ci respecte évidemment la structure hiérarchique de spécification.
Elle se compose d’une première fenêtre (figure 3.29) permettant d’ajouter, de modifier ou de supprimer des macros-déplacements et les déplacements correspondants, ainsi que de définir les caractéristiques de chacun en termes de tenue et de répétition.
La définition proprement dite des déplacements est effectuée dans une suite de fenêtres enchaînées, similaires aux assistants que l’on trouve dans divers logiciels professionnels. Cela permet de progresser ou de revenir sur ses pas dans son travail (figure 3.30). |
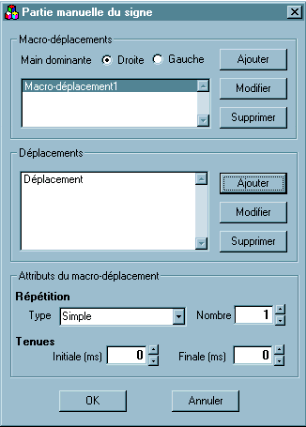 |
|
|
|
Ainsi, la première étape consiste à choisir la structure de base du déplacement. En fonction de ce choix, l’utilisateur est alors invité à spécifier la ou les primitive(s) de déplacement, ceci à l’aide d’outils adaptés dans lesquels il peut visualiser l’effet de ses choix successifs sur la posture du signeur virtuel (voir figure 3.31).
Au cas où les deux articulateurs sont impliqués
dans le signe, il convient également de préciser
la relation unissant leurs déplacements respectifs (type
et plan de symétrie), ou bien les deux primitives de déplacement
s’il n’existe aucune relation.
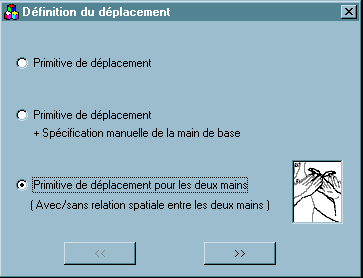 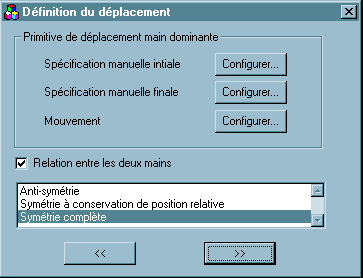 |
|
|
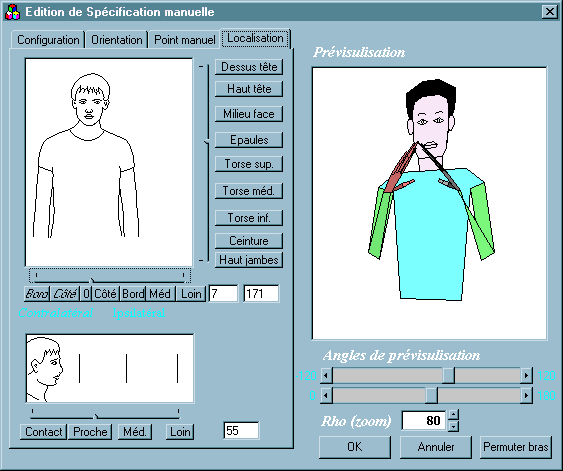 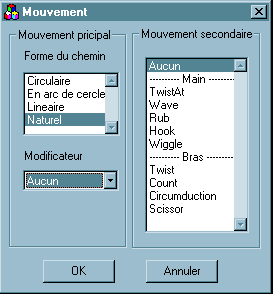 |
|
|
Par une démarche progressive et logique, l’utilisateur
spécifie aisément les différentes caractéristiques
du signe. Le logiciel convertit ensuite la structure bâtie
en mémoire par ce biais en sa représentation textuelle
destinée à être insérée comme
description de la partie manuelle du signe. Lors de l’évaluation,
c’est exactement l’opération inverse qui est
réalisée. Pour garantir cette correspondance biunivoque,
un soin tout particulier a été porté lors
de l’écriture des méthodes correspondantes.
3.3.1.3. Le module de visualisation 3D.
L’animation générée se compose d’une
série d’images avec, pour chacune, les coordonnées
spatiales des sommets de tous les polygones composant le signeur.
Ce n’est qu’au moment de tracer effectivement ces figures
que leurs points sont projetés sur le plan de vision, ce
qui permet de changer si besoin l’angle de vue de la caméra
pour mieux en apprécier tel ou tel détail.
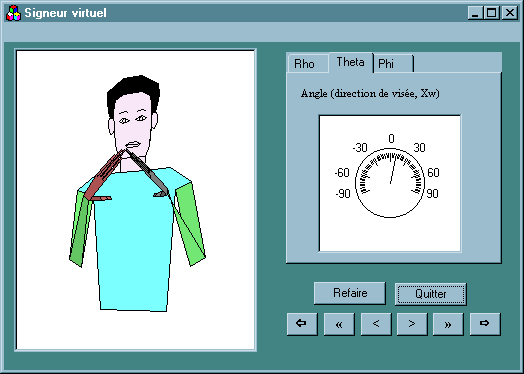 |
|
|
La fenêtre présentant les signes synthétiques
(figure 3.32) offre cette possibilité
sous forme de cadrans gradués (un pour l’azimut, un
pour l’élévation et un pour la distance à
la caméra). En outre, l’animation peut être
rejouée, et son film rembobiné ou déroulé
pas à pas grâce à une série de boutons
rappelant ceux des appareils audiovisuels grand public.
3.3.1.4. Le dictionnaire de signes.
Les signes sont regroupés dans un dictionnaire visant
à en faciliter la gestion. La structure de celui-ci est
classique, avec une clé alphabétique à laquelle
est associé un ensemble de valeurs. La clé est constituée
du nom complet du signe (y compris, le cas échéant,
les caractères spéciaux ‘_’, ‘-’
et ‘>’) ; elle identifie chaque entrée de
manière unique et n’accepte donc pas les doublons.
Les champs associés sont présentés dans le
tableau 3.9 sur un exemple. Il s’agit
notamment d’une liste (champ synonymes) de traductions
françaises acceptables outre la clé, et de la technique
de localisation à utiliser préférentiellement
pour ce signe.
Ces différents champs sont pris en compte lors de l’évaluation
de la phrase signée, ce qui permet par exemple d’utiliser
indifféremment l’un des synonymes, ou de connaître
les flexions admises pour un signe donné.
| Clé | 'cheminée' |
| Code IVT | 38 |
| Thème(s) | 1 [La maison] |
| Description textuelle |
'Sign %Cheminée . Manual: (Shift from:(HandSpec config:#C point:#ThumbRoot at: [Shoulders¶ FrontProx Sagittal] ori: [f f & u]) to: [Shoulders FrontProx IpsiSide] move: #Linear weakMove: #Symmetrical), (Shift from: ( HandSpec ori: [f f & i u] ) to: (HandSpec at:[MidTorso FrontProx IpsiSide] ori:[f f & i]) move: #Linear weakMove: #Symmetrical).' |
| Synonymes | #() [Aucun] |
| Précisions sémantiques | nil [Non renseigné] |
| Classe de lexème | 1 [Substantif] |
| Technique de localisation | 1 [Déplacement du signe] |
| Flexion(s) possible(s) | #( #(Grande Large Big) ) |
| Traduction(s) anglaise(s) | #(Chimney Fireplace) |
| Remarques | nil [Non renseigné] |
|
|
|
Remarque : Les traductions en anglais présentes dans le dictionnaire ne se rapportent pas au signe, mais à son (ses) équivalent(s) en français. Il ne s’agit là que d’un artifice pour présenter ces travaux sur la LSF dans la langue de Shakespeare, indépendamment de la forme réelle en ASL (et a fortiori en langue des signes britannique).
| Le dictionnaire est lui aussi doté d’une interface graphique, dont l’un des composants permet l’édition d’une entrée (en proposant les valeurs possibles pour les différents champs sous forme de listes déroulantes), et l’autre facilite la sélection d’un signe dans la base de données. Pour cela, l’utilisateur a le choix entre une recherche alphabétique directe, ou selon le code, le thème ou la classe du lexème (figure 3.33). |
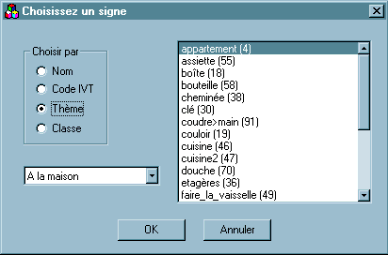 |
|
|
|
Le dictionnaire est stocké à la fois en mémoire
volatile et sur le disque rigide pour assurer la pérennité
des données. Il lui correspond un fichier unique qui est,
comme dans toute base de données correctement conçue,
remis à jour dès qu’une description de signe
est validée. On évite ainsi au maximum la perte
d’information en cas d’incident technique. Ce mécanisme
de sauvegarde est illustré sur la figure
3.34, qui reprend l’organisation globale de l’interface
graphique du système.
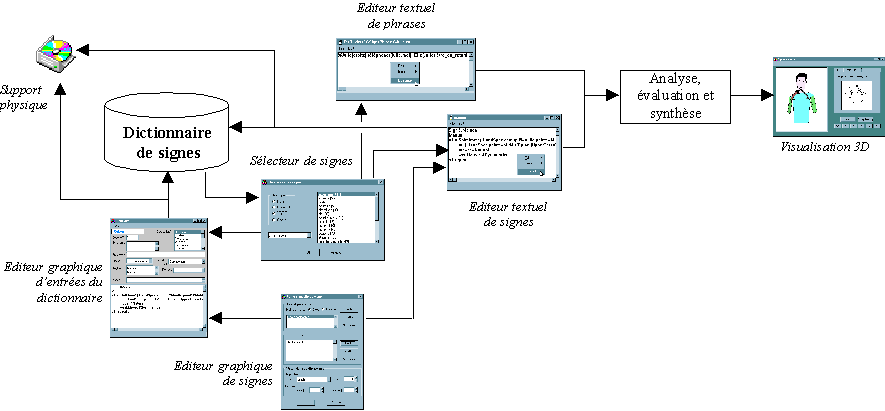 |
|
|
3.3.2. Evaluation des signes
synthétiques et application.
Dès lors que la génération des signes synthétiques est parvenue à un niveau suffisant d’élaboration, nous avons souhaité soumettre les animations produites à une procédure de validation par des personnes maîtrisant la langue des signes.
Cette partie présente d’abord le protocole mis
sur pied à cette fin, puis les enseignements que les résultats
ont permis d’en tirer. Pour finir, nous exposons, à
travers l’intégration au logiciel LAC, un exemple
concret d’utilisation qui illustre parfaitement tout le parti
à tirer d’un tel système de synthèse.
3.3.2.1. Mode opératoire.
Le protocole expérimental d’évaluation a été conçu de façon à pouvoir effectuer la validation à distance et de manière autonome. Pour cela, nous avons tiré profit des capacités d’HTML à inclure différents types de média (textes, images, mais aussi vidéos grâce à l’incrustation d’objets).
Seule l’évaluation des signes en forme de citation (i.e. non fléchis, comme dans un dictionnaire) a été ainsi réalisée. Elle se présente comme 5 pages de 10 signes, la première étant introduite par quelques explications sur leur utilisation. Les résultats (i.e. les données contenues dans les champs) sont transmis par courrier électronique au moyen d’un bouton d’envoi à la fin de chacun des 5 formulaires.
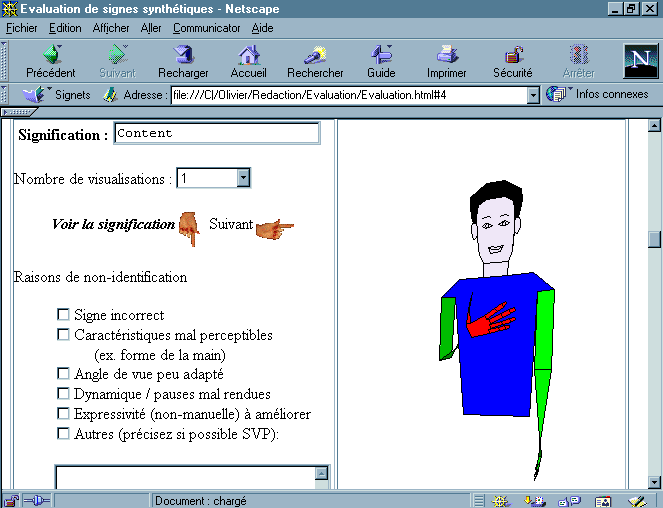 |
|
|
Le sujet est invité, pour chaque signe, à inscrire le sens qu’il a perçu (cf. figure 3.35) et à indiquer le nombre de fois où il a visualisé l’animation (ce qui donne une indication quant à l’aisance de compréhension). Il peut ensuite découvrir la signification du signe et voir si elle coïncide avec sa propre réponse. Nous lui demandons, si l’identification n’est pas sémantiquement proche du sens théorique, d’essayer de préciser la ou les raison(s) de cette différence. Plusieurs facteurs peuvent a priori intervenir :
Rappelons à ce propos que les signes sont susceptibles
de varier fortement d’un pays, d’une région,
et même d’un établissement à l’autre,
et que les formes représentées dans le dictionnaire
d’IVT ne sont pas systématiquement identiques partout
en France. De plus, quoique les dessins en soient très
parlants, une erreur d’interprétation – et donc
d’encodage - n’est jamais à exclure.
Si l’utilisateur ne reconnaît dans aucun des points
ci-dessus une raison valable pour laquelle il n’aurait pas
identifié le signe, il lui est tout de même demandé
d’avancer une autre explication.
3.3.2.2. Résultats et conclusions de l’évaluation.
Pour l’évaluation, nous avons sollicité la collaboration de plusieurs structures en relation directe avec les sourds :
Plusieurs membres de chaque structure ont visualisé
globalement les signes synthétiques. En soulignant tout
l’intérêt qu’ils portaient à ce
projet, ils nous ont adressé d’utiles remarques que
nous souhaitons relater ici. Pour le moment, ont utilisé
intégralement le module d’évaluation des signes
Françoise Casas[42],
Sandrine Trottin[43],
Frédéric Harlez, Sandra Tellier et Nathalie Cruaud[44], ainsi que quatre jeunes
déficients auditifs de Pont-à-Marcq. Ce sont leurs
résultats (consignés dans le tableau 3.10), que
corroborent largement les observations des autres sourds rencontrés,
dont nous allons tirer les principaux enseignements.
Deux remarques préalables s’imposent :
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
||||||
| Test 1 |
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Test 2 |
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Test 3 |
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tests 4-7[47] |
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Test 8 |
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Test 9 |
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
Il ressort de cette évaluation que plus des deux tiers
à 80% des signes, selon l’informateur, ont été
correctement interprétés. De plus, parmi les réponses
inexactes, un grand nombre s’explique par la méconnaissance
de la forme proposée ; très peu sont réellement
dues aux modes mêmes de représentation ou de génération
du mouvement (autour de 5 seulement, soit un dixième du
total). Les raisons majoritairement incriminées ont trait
au discernement des caractéristiques manuelles, et tout
particulièrement à celle des configurations (comme
le remarquent l’ensemble des personnes ayant visualisé
les signes). L’amélioration du rendu des formes de
la main doit donc être une priorité dans les travaux
à venir. De même que la perception des autres segments
et de leur profondeur, le problème de l’identification
des configurations manuelles trouverait très certainement
une réponse adaptée dans une modélisation
volumique affinée du signeur (sous forme de surface maillée
par exemple).
Pour détailler quelque peu les riches remarques fournies, on peut évoquer les points suivants :
Ces quelques résultats, quoiqu’encourageants, ont
encore besoin d’être étayés et la collaboration
engagée avec les associations citées ci-dessus s’inscrit
notamment dans cette perspective. A très court terme, nous
devrions être en mesure de préciser ces observations,
dans le but de corriger les imperfections du système de
synthèse et d’en combler les lacunes principales.
Dans un second temps, nous souhaitons mettre le logiciel dans
son ensemble à la disposition de l’utilisateur, de
façon à perfectionner l’interface d’édition.
3.3.2.3. Application : inclusion au logiciel LAC.
Pour clore cette partie, nous allons exposer brièvement
comment le générateur de signes synthétiques
a été mis à profit dans le logiciel LAC,
évoqué au premier chapitre. Une des motivations
pour l’obtention de signes virtuels était de résoudre
le problème posé par la création des vidéos,
ainsi que le stockage des volumineux fichiers correspondants.
Le système que nous avons bâti apporte une solution
concrète à ces écueils, grâce à
son interface graphique permettant une édition aisée
des signes, et à la concision de l’information ainsi
générée. La production fluide d’une
phrase quelconque est également possible, pour peu que
l’on ait créé ses signes constitutifs au préalable.
Le générateur de signes a été d’abord
connecté au travail de V. Vanneste sur l’analyse syntaxique
de la phrase française. Cet ensemble a ensuite été
intégré au logiciel LAC [CAN 99], pour pouvoir y traduire de façon
automatique non seulement les mots et thèmes du corpus,
mais encore les phrases illustratives présentées
pour chacun. Ces dernières se limitent pour l’heure
à quelques structures, car la grammaire sur laquelle est
basée l’analyse syntaxique est limitée ; on
ne dispose de surcroît d’aucun analyseur sémantique.
Ce prototype de système de traduction a néanmoins
permis d’en démontrer la faisabilité, à
travers un petit corpus exemple ayant trait aux pièces
de la maison. Celui-ci a été choisi car nous disposions
déjà, dans le dictionnaire, de bon nombre de signes
relatifs à ce thème.
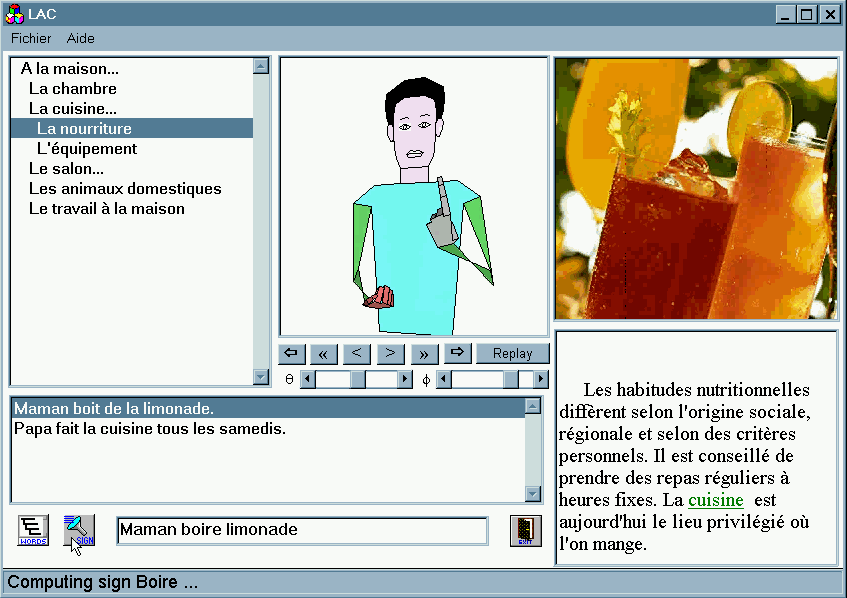 |
|
|